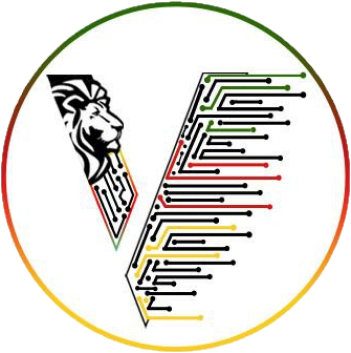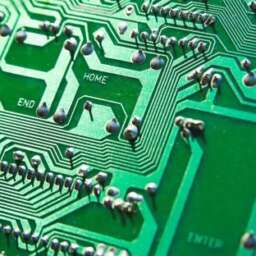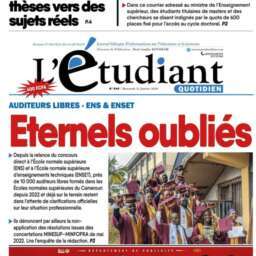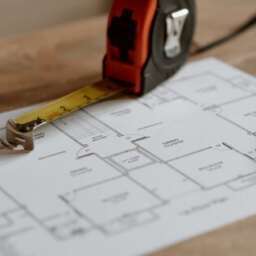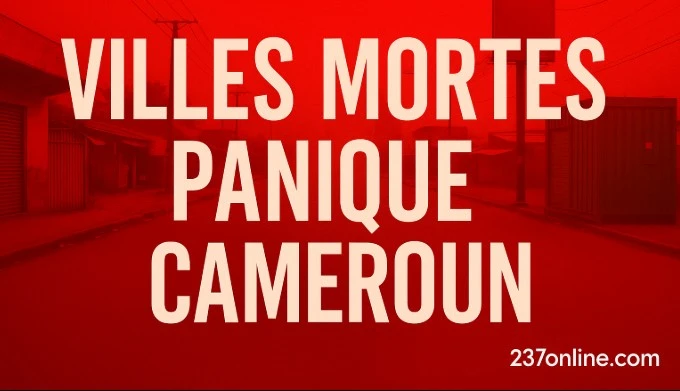Depuis trois jours, les rues sont désertes, les boutiques fermées, les taxis rares, les marchés silencieux. L’opération « villes mortes », soutenue par une partie de l’opposition dans le contexte post-électoral, provoque à la fois panique et incompréhension. Dans les quartiers, certains disent « on n’a pas le choix », d’autres redoutent la répression. « Mon frère a été blessé par balle, on ne comprend plus rien à ce qui se passe », confie Idriss Sandjong, vigile, depuis son lit à l’hôpital régional.
Cette paralysie peut-elle réellement faire bouger le pouvoir, ou ne fait-elle qu’accentuer la souffrance des populations ?
Sur le terrain : peur, silence et attentes sous tension
À 17 heures tapantes, le 4 novembre, Idriss est touché par balle devant la Cca Bank Bafoussam.
Transporté d’urgence, il a repris connaissance : « Je ne sais pas ce qui s’est passé. On parlait juste, après ça a tiré. »
Dans plusieurs quartiers, la méfiance règne. Entre checkpoints improvisés, patrouilles et rumeurs en cascade, les habitants vivent au rythme des informations contradictoires.
Dans la zone de Tougang-village, la population observe strictement « l’ordre » des villes mortes.
À Terminus, certains osent revenir vers les commerces, mais les rues restent à moitié vides.
Résultat :
– Les petits commerçants perdent leurs revenus.
– Les taxis roulent à moitié.
– Les familles hésitent à envoyer les enfants à l’école.
– Les agriculteurs retardent la sortie pour les champs.
« Si on ne vend pas, on ne mange pas. Mais si on sort, on peut mourir. On fait comment ? », murmure une vendeuse de beignets à Tamdja.
« Villes mortes » : protestation populaire ou nouvelle forme de précarité ?
Une crise qui touche d’abord les plus pauvres
La mesure touche surtout ceux qui vivent au jour le jour.
À Bamendzi, une mère explique :
« Je dois payer les cahiers des enfants. Si je ne sors pas vendre, qui va me sauver ? »
Cette paralysie révèle une fracture sociale profonde :
– Ceux qui ont des réserves se terrent.
– Ceux qui n’ont rien sont forcés de braver la peur.
Un cadre du SDF à Bafoussam II souligne :
« La bataille pour le pays ne doit pas se gagner sur le dos des plus pauvres. »
Le capitalisme du pauvre : quand la survie prend le pas sur la politique
À la radio locale, on parle déjà de « capitalisme du pauvre » :
une économie où chacun se débrouille seul, où l’État apparaît lointain, et où la politique devient une question de survie immédiate.
« On nous demande de nous battre, mais le pain coûte déjà trop cher »,
lâche un moto-taximan, casque en main.
Dans ce contexte, la prestation de serment de Paul Biya, prévue dans les prochains jours, apparaît pour certains comme un moment symbolique qui pourrait réduire les tensions… ou les accentuer.
Si l’opération « villes mortes » voulait montrer la colère d’une partie du peuple, elle a également mis en lumière la fragilité de millions de Camerounais.
Reste une question cruciale :
Comment protester sans se blesser soi-même ?