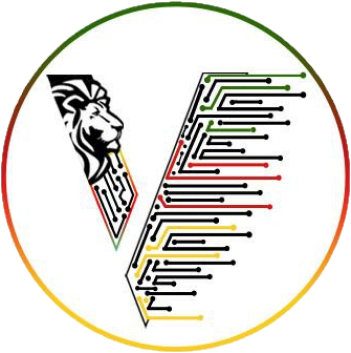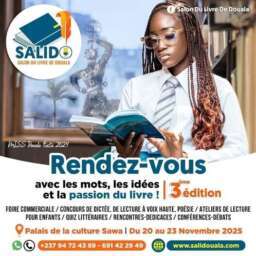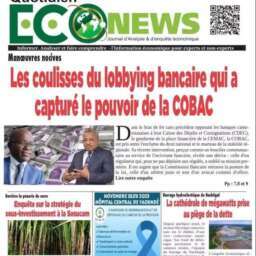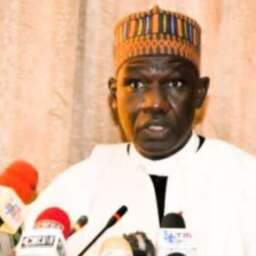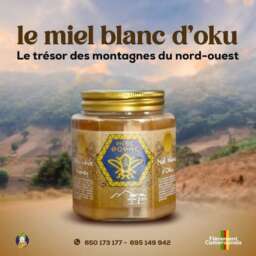523 familles royales règnent encore sur le littoral ! Les Sawas du Cameroun forment depuis des siècles une aristocratie bantoue qui contrôle les terres côtières, de Limbé à Kribi. Alors que Douala s’impose comme poumon économique du pays, ces dynasties millénaires maintiennent leur emprise sur le foncier, la tradition et même la politique moderne. Un pouvoir ancestral que rien ne semble pouvoir ébranler.
Sawas du Cameroun : les véritables maîtres de la côte depuis 600 ans
Dans la cour sacrée du royaume Bakoko, au bord du Wouri, le roi Erick Jamil Songue, 40 ans seulement, incarne cette permanence du pouvoir traditionnel. « Les Sawas sont un peuple très résilient. Nous sommes entrés en contact très tôt avec l’Occident sans perdre nos racines », affirme le jeune monarque, drapé dans son pagne traditionnel.
Le terme « Sawa » lui-même signifie « gens de la côte » en langue duala. Il désigne un ensemble complexe de peuples bantous : Bakoko, Bassa’a, Duala, Bakweri, Malimba, Ewodi, Isubu, Bodiman et Wovea. Chacun possède sa langue, ses rites secrets, mais tous partagent cette conception de la famille comme socle du pouvoir.
Les Sawas du Cameroun ont bâti leur puissance sur une organisation sociale sophistiquée. Chez les Bakoko par exemple, la société s’articule autour des clans patrilinéaires appelés « mbo’o ». On dénombre aujourd’hui dix grands clans fondateurs : les Mbongo, Ekambeng, Londji, Elog-Ngoma, Yamb, Ndanga, Lokombe, Mpanda, Bessong et Mbeng.
Ces lignées contrôlent des territoires immenses autour d’Édéa, Loum, Souza, Yabassi, Ngambé et Dizangué. Là-bas, leur parole fait encore loi. Les conflits fonciers ? C’est d’abord chez eux qu’on les règle. Les mariages ? Impossible sans leur bénédiction.
Les Bell, Akwa, Deïdo : ces dynasties qui ont façonné l’histoire du Cameroun
Mais c’est à Douala que le pouvoir sawa s’exprime avec le plus d’éclat. Trois grandes maisons dominent la ville depuis le XIXe siècle, véritables dynasties marchandes qui ont négocié d’égal à égal avec les puissances coloniales.
La maison Bell, installée à Bonanjo, descend directement de Ndumbe Lobe Bell, le fameux « King Bell » qui signa le traité germano-douala de 1884. C’est ce traité qui plaça le Cameroun sous protectorat allemand. Aujourd’hui, Jean-Yves Eboumbou Douala Bell, 69 ans, neuvième de la dynastie, règne sur le Canton Bell.
« Je représente une continuité dynastique assumée. Le sens dynastique, c’est permettre à chacun de retrouver sa place dans la communauté », explique le monarque dans son palais de Bonanjo. Son ancêtre Rudolf Douala Manga Bell, pendu par les Allemands le 8 août 1914 pour avoir résisté à l’expropriation coloniale, reste le symbole de la résistance sawa.
La maison Akwa, rivale historique des Bell, contrôle Bonabéri et Bonakwa. Cette puissante famille de négociants a longtemps dominé le commerce avec les Européens. Leurs entrepôts sur les berges du Wouri ont vu passer l’ivoire, l’huile de palme, le caoutchouc qui ont fait la richesse de Douala.
La maison Deïdo, sur la rive nord du fleuve, conserve une autorité spirituelle incontestée. C’est là que se trouvent les sites sacrés les plus importants des Duala. Aucune décision majeure concernant la ville ne se prend sans consulter le chef Deïdo.
À ces trois piliers s’ajoutent les lignées Essengue, Bonambela, Bonabéri, Bonamoussadi, Bonapriso, New Bell et Youpwé. Moins médiatisées, elles n’en sont pas moins puissantes. C’est souvent chez elles que se règlent discrètement les conflits fonciers qui agitent la métropole.
Le Ngondo : quand 300.000 Sawas se rassemblent chaque décembre
Chaque année, le premier dimanche de décembre, Douala vit au rythme du Ngondo. Cette assemblée traditionnelle rassemble tous les peuples sawas dans une démonstration de force impressionnante. Plus de 300.000 personnes convergent vers les berges du Wouri pour célébrer l’unité sawa.
« Le Ngondo est un parlement de la tradition, une instance de régulation et de mémoire », insiste le roi Bell. Loin d’être du folklore pour touristes, c’est un véritable gouvernement parallèle qui se réunit. Les chefs y débattent des questions foncières, des mariages, des successions, mais aussi de politique nationale.
Le rituel central reste l’immersion du vase sacré dans le Wouri. Un initié plonge dans les eaux troubles du fleuve pour aller chercher les messages des ancêtres. Ce qu’il en ramène détermine l’orientation de l’année à venir pour tout le peuple sawa. En 2024, les esprits avaient prédit « une année de bouleversements politiques« . On ne peut dire qu’ils se sont trompés…
Durant le Ngondo, les familles royales sawas déploient toute leur magnificence. Pagnes traditionnels brodés d’or, sceptres sculptés transmis depuis des générations, trônes en ébène… C’est l’occasion de rappeler au Cameroun moderne que le pouvoir traditionnel reste bien vivant.
Au-delà de Douala : l’empire sawa s’étend sur 300 kilomètres de côtes
Les Sawas du Cameroun ne se limitent pas à Douala. Leur territoire s’étend sur toute la façade atlantique, de la frontière nigériane au nord jusqu’à Kribi au sud.
Les Bakweri règnent sur les flancs du mont Cameroun, autour de Limbé et Buéa. Les familles Liwonde, Mokole, Endale, Elonge et Ekolong y perpétuent des rites millénaires liés au volcan sacré qu’ils appellent « Fako« . Leurs cérémonies de guérison attirent des malades de tout le pays.
Les Malimba (ou Limba) contrôlent l’embouchure de la Sanaga, entre Mouanko et Manoka. Les familles Likwele, Ebongo, Ndoke et Epassa y maintiennent des traditions de pêche rituelle qui remontent, dit-on, au XIIIe siècle. Personne ne peut jeter ses filets dans ces eaux sans leur autorisation.
Les Isubu, établis autour de Bimbia et Victoria (l’actuelle Limbé), gardent la mémoire de William de Bimbia, figure royale légendaire dont la descendance exerce toujours un pouvoir spirituel considérable. C’est chez eux que les missionnaires baptistes s’installèrent en premier au XIXe siècle.
Cette géographie du pouvoir sawa n’est pas qu’symbolique. Elle a des conséquences très concrètes sur le développement économique de la région. Aucun projet d’envergure ne peut voir le jour sur le littoral sans l’aval des chefferies traditionnelles.
Foncier urbain : le nerf de la guerre entre tradition et modernité
C’est sur la question foncière que le pouvoir des Sawas du Cameroun s’exprime avec le plus de force. À Douala, pas un mètre carré n’échappe théoriquement au contrôle des familles royales. Elles détiennent des droits coutumiers issus des systèmes précoloniaux que même l’État moderne peine à contester.
Cette mainmise sur le foncier génère des tensions permanentes. En 2023, le conflit autour du projet de port en eau profonde de Kribi a opposé frontalement le gouvernment aux chefferies Batanga et Mabi. Résultat : le projet a pris deux ans de retard et coûté 50 milliards de FCFA supplémentaires en « arrangements » divers.
À Bonanjo, cœur des affaires de Douala, la famille Bell revendique toujours la propriété de terrains aujourd’hui occupés par des immeubles de bureaux. « Nous n’avons jamais vendu ces terres. Elles ont été confisquées par l’administration coloniale », martèle le roi Bell. Des procès interminables opposent la chefferie aux investisseurs.
Face à cette situation explosive, plusieurs familles sawas ont entamé un travail de modernisation. Archives numérisées, cartographie GPS des territoires traditionnels, documentation généalogique… Les moyens du XXIe siècle au service d’un pouvoir millénaire.
« Nous créons une base de données qui prouvera nos droits de manière incontestable », explique un jeune prince Akwa, diplômé de Harvard. Cette nouvelle génération, formée dans les meilleures universités occidentales, revient au pays avec l’ambition de moderniser les structures traditionnelles sans les dénaturer.
Les Sawas dans la politique moderne : une influence discrète mais réelle
Si les Sawas du Cameroun évitent généralement de s’afficher en politique, leur influence n’en est pas moins réelle. Aucun candidat à la mairie de Douala ne peut espérer l’emporter sans le soutien, au moins tacite, des grandes familles.
En 2020, lors des élections municipales, les trois principaux candidats ont tous fait le pèlerinage chez les chefs Bell, Akwa et Deïdo. « Celui qui obtient la bénédiction des trois maisons a déjà gagné », confie un observateur politique local.
Cette influence s’étend au niveau national. Plusieurs ministres actuels sont issus de familles royales sawas. Ils forment un réseau discret mais efficace, capable de bloquer ou d’accélérer des dossiers stratégiques. Le port autonome de Douala, la Société nationale de raffinage, Camair-Co… autant d’entreprises publiques où l’influence sawa se fait sentir.
Mais cette omniprésence suscite aussi des critiques. Les autres communautés du Cameroun dénoncent parfois un « monopole sawa » sur les affaires du littoral. Des tensions qui s’exacerbent lors des nominations dans l’administration ou l’attribution des marchés publics.
Entre tradition et modernité : le défi de la transmission
Comment transmettre des traditions séculaires à une jeunesse connectée, urbanisée, mondialisée ? C’est le défi majeur auquel font face les Sawas du Cameroun aujourd’hui.
« Les jeunes ne parlent plus duala. Ils ne connaissent pas les rites, les danses, les chants », déplore un vieux chef de Bonabéri. Dans les quartiers populaires de Douala, on préfère le rap américain aux rythmes traditionnels de l’Essèwè ou du Mbassé.
Pour contrer cette érosion culturelle, les chefferies multiplient les initiatives. Écoles de langue duala, camps de vacances traditionnels, applications mobiles pour apprendre les généalogies… « Tradition et modernité ne sont pas opposées. La vraie modernité commence par la connaissance de soi », philosophe le roi Bell.
Certaines familles vont plus loin. Les Akwa ont créé une fondation qui octroie des bourses aux jeunes Sawas méritants, à condition qu’ils s’engagent à revenir servir la communauté. Les Deïdo financent un centre culturel ultramoderne où se mêlent cours de danse traditionnelle et studio d’enregistrement numérique.
Cette adaptation passe aussi par les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, Facebook, TikTok, les jeunes princes et princesses sawas affichent fièrement leur héritage. Videos de cérémonies traditionnelles, stories en langue duala… La tradition 2.0 en quelque sorte.
L’économie sawa : du commerce triangulaire aux startups
L’ADN commercial des Sawas du Cameroun ne date pas d’hier. Dès le XVIIe siècle, les ancêtres des actuelles familles royales contrôlaient le commerce entre l’intérieur du pays et les navires européens. Ivoire, esclaves (hélas), huile de palme, caoutchouc… Tout transitait par leurs mains.
Aujourd’hui, cet esprit entrepreneurial perdure. Les grandes familles sawas sont présentes dans tous les secteurs de l’économie camerounaise. Import-export, immobilier, transport, finance… Leur réseau tentaculaire facilite les affaires.
La Société Akwa, fondée dans les années 1950, reste l’un des plus grands groupes privés du pays. De la distribution pétrolière à l’hôtellerie de luxe, l’empire familial pèse plusieurs centaines de milliards de FCFA. « Nous sommes des commerçants dans l’âme. C’est notre histoire, notre identité », revendique l’actuel PDG, petit-fils du fondateur.
Les Bell ne sont pas en reste. Leur holding contrôle des participations dans les télécoms, la banque, l’agro-industrie. Sans compter les revenus fonciers considérables tirés de leurs propriétés à Douala.
Mais la nouvelle génération veut aller plus loin. Des incubateurs de startups voient le jour, financés par les familles royales. L’objectif ? Créer une Silicon Valley sawa qui marie tradition et innovation. « Nous avons l’expérience du commerce, les réseaux, les capitaux. Il nous manquait la tech. Les jeunes l’apportent », analyse un investisseur de la diaspora.
Les femmes sawas : un pouvoir méconnu mais réel
Si les chefferies sawas restent majoritairement masculines, les femmes y exercent un pouvoir considérable, quoique discret. Les « mama » des grandes familles sont souvent les véritables décideuses dans l’ombre.
Prenez Mama Akwa, 85 ans, matriarche incontestée de sa lignée. Aucune décision importante ne se prend sans son aval. C’est elle qui choisit les épouses de ses fils, négocie les alliances entre familles, gère les conflits internes. « Les hommes parlent, les femmes décident », sourit-elle malicieusement.
Cette influence féminine s’exprime particulièrement dans les sociétés secrètes féminines comme le Muengu ou le Losango. Ces confréries, dont les rites restent jalousement gardés, jouent un rôle crucial dans la régulation sociale. Elles peuvent faire ou défaire une réputation, bénir ou maudire une union.
Les princesses sawas modernes bousculent encore plus les codes. Avocates, médecins, entrepreneuses… Elles revendiquent leur place dans les instances traditionnelles. Certaines ont même été nommées cheffes de quartier, une révolution dans ce monde patriarcal.
Spiritualité sawa : quand les ancêtres gouvernent les vivants
Au cœur du pouvoir des Sawas du Cameroun se trouve une spiritualité complexe où les morts continuent de régner sur les vivants. Chaque famille royale possède ses sites sacrés, ses autels ancestraux, ses rites secrets.
Le culte des ancêtres structure toute la vie sociale. Avant chaque décision importante, on consulte les mânes familiaux. Des cérémonies nocturnes, interdites aux non-initiés, permettent de communiquer avec l’au-delà. « Nos ancêtres nous guident. Ils voient ce que nous ne voyons pas », assure un chef coutumier.
Cette dimension spirituelle n’est pas qu’folklore. Elle a des conséquences très concrètes. En 2022, le projet d’autoroute Douala-Yaoundé a dû être dévié de plusieurs kilomètres pour éviter un bosquet sacré des Bakoko. Coût supplémentaire : 15 milliards de FCFA. Mais toucher à ce lieu aurait déclenché, assure-t-on, « des malheurs terribles ».
Les génies de l’eau, les « miengu« , occupent une place particulière dans cette cosmogonie. Ces esprits aquatiques, mi-hommes mi-poissons, habitent le Wouri et ses affluents. Ils peuvent apporter richesse et prospérité, mais aussi déchaîner leur colère si on les offense. D’où l’importance du Ngondo, qui vise notamment à les apaiser.
Cette spiritualité sawa influence même le monde des affaires modernes. Nombreux sont les entrepreneurs qui font bénir leurs projets par les chefs traditionnels. « Un business qui n’a pas la bénédiction des ancêtres est voué à l’échec », affirme avec conviction un homme d’affaires de Bonanjo.
Sawas du Cameroun : quel avenir pour ces monarchies du XXIe siècle ?
Alors que le Cameroun s’urbanise à vitesse grand V, que la mondialisation uniformise les cultures, quel avenir pour les dynasties sawas ? La question divise les observateurs.
Les pessimistes prédisent un déclin inexorable. « Dans vingt ans, il ne restera que du folklore pour touristes », prophétise un sociologue de l’université de Douala. La pression foncière, l’exode rural, l’occidentalisation des mœurs… Autant de facteurs qui érodent le pouvoir traditionnel.
Mais sur le terrain, les Sawas du Cameroun montrent une remarquable capacité d’adaptation. Ils investissent dans l’éducation, modernisent leurs structures, s’allient avec le pouvoir politique et économique moderne. « Nous avons survécu à la traite négrière, à la colonisation, aux indépendances. Nous survivrons à la mondialisation », assure avec fierté le roi Bakoko.
Le secret de cette résilience ? « La mémoire est un pouvoir. Elle fonde l’autorité, la légitimité et le lien au sol », résume Erick Jamil Songue. Tant que les Sawas se souviendront d’où ils viennent, ils sauront où ils vont.
Un proverbe duala dit : « Le passé, c’est le présent passé. Le futur, c’est le présent futur. » Dans cette conception cyclique du temps, les dynasties sawas ne disparaissent jamais vraiment. Elles se transforment, s’adaptent, renaissent. Comme le Wouri qui coule, immuable, au cœur de leur territoire ancestral.
Les jeunes générations sawas l’ont bien compris. Entre tradition et modernité, ils inventent une nouvelle façon d’être sawa au XXIe siècle. Connectés au monde mais ancrés dans leur terre. Modernes mais respectueux des ancêtres. C’est peut-être là, dans cette synthèse créative, que se trouve l’avenir des monarchies sawas.
Car au fond, ce que nous enseignent les Sawas du Cameroun, c’est qu’une société ne peut se construire en faisant table rase du passé. Les racines ne sont pas des chaînes, mais des fondations. Sur elles, on peut bâtir l’avenir. Un avenir où tradition et modernité dansent ensemble, au rythme lancinant des tam-tams du Ngondo.
Les familles royales sawas vont-elles réussir leur pari de modernisation sans perdre leur âme ?