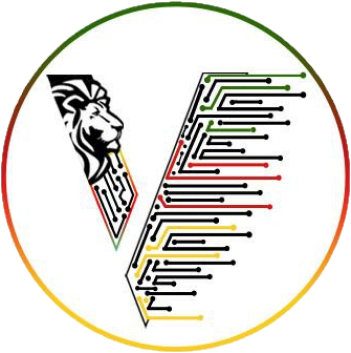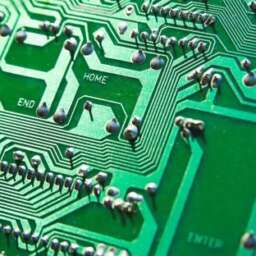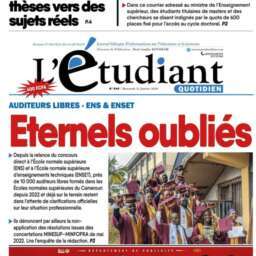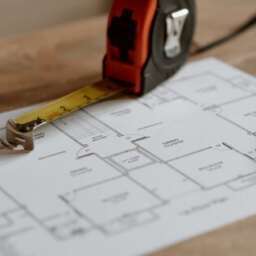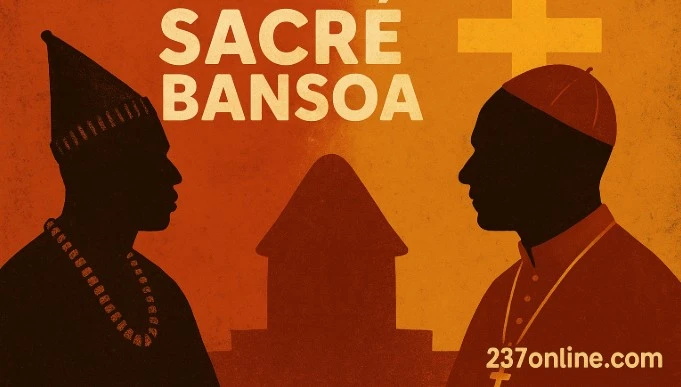La chefferie supérieure Bansoa prépare avec faste le sacre de l’Abbé David Gomsi Boucheke, premier évêque originaire du groupement, attendu à Douala le 23 novembre 2025. Mobilisation générale, appels publics, fierté unanime. Et pourtant, dans l’ombre des réjouissances, une question identitaire profonde traverse la communauté :
comment célébrer un prêtre issu d’une tradition chrétienne alors que, dans la culture Bansoa, le Chef est lui-même garant du sacré, détenteur du culte ancestral et prêtre suprême de la terre ?
« Le Chef, c’est celui qui parle aux ancêtres, qui assure la continuité de la vie », rappelle un notable du La’akam.
Alors, que révèle réellement cette célébration ?
Une fierté légitime… mais porteuse d’ambiguïtés
L’ordination d’un fils Bansoa à l’épiscopat est, de fait, un accomplissement collectif.
Elle souligne :
- la vitalité intellectuelle du groupement,
- la participation à la scène religieuse nationale,
- l’ouverture aux dynamiques contemporaines.
Mais dans la cosmologie traditionnelle Bansoa :
- le Chef n’est pas qu’un dirigeant administratif,
- il est chef religieux,
- médiateur entre les vivants et les ancêtres,
- gardien des autels sacrés.
C’est cela qui crée la tension symbolique.
Un enseignant en histoire des religions à l’université de Yaoundé 1 explique :
« Quand un peuple célèbre un autre clergé, il reconnaît implicitement une autre source du sacré. Cela peut enrichir… ou diluer. La question n’est pas la fête. La question est : qui bénit qui ? »
Deux spiritualités, une seule communauté
Le Chef : sacré, ancestral, immémorial
Dans la tradition :
- le Chef ne prie pas,
- il incarne la prière collective.
- Sa parole est rite.
- Son corps est sanctuaire.
Le Chef n’est pas “homme de Dieu” : il est signe du peuple.
L’Évêque : ministre du sacré chrétien
L’évêque reçoit :
- une légitimité institutionnelle (Église),
- une mission pastorale (fidèles),
- une autorité doctrinale (sacrement).
Ces deux positions ne s’opposent pas, mais elles ne sont pas identiques.
Alors, que célèbre-t-on vraiment ?
Certains y voient :
- une modernité assumée,
- une coexistence harmonieuse entre ancestralité et christianisme.
D’autres perçoivent :
- une fragilisation de l’autorité sacrée traditionnelle,
- un glissement progressif vers une externalisation du sacré.
Une femme du quartier Ngouache résume simplement :
« Si le Chef est déjà le père spirituel, pourquoi acclamer un autre père ? Le peuple doit réfléchir. La joie n’empêche pas la conscience. »
La célébration du futur évêque n’est pas anodine.
Elle touche le cœur de l’identité Bansoa :
Qui sommes-nous lorsque le sacré se multiplie ?
Comment maintenir la continuité ancestrale tout en s’ouvrant au monde ?