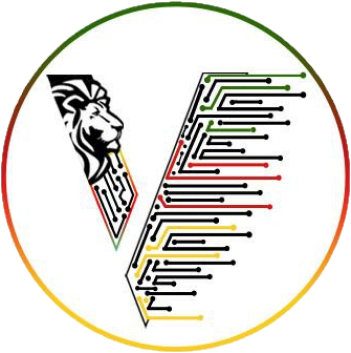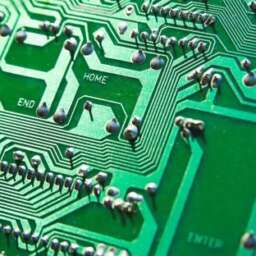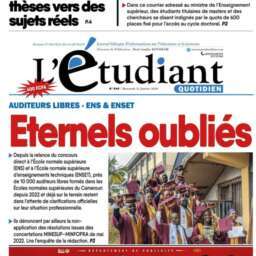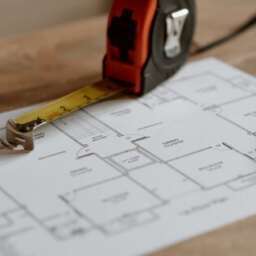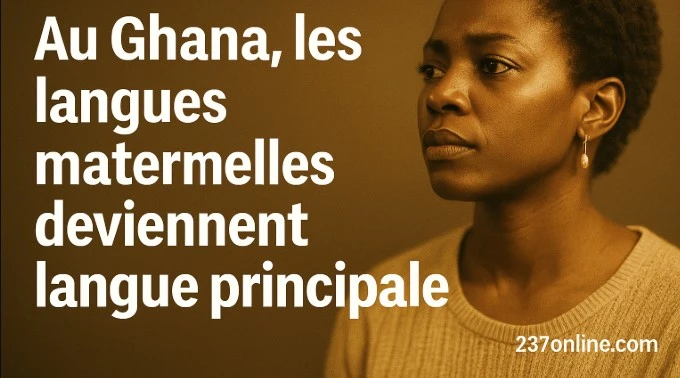Le Ghana vient de surprendre le continent avec une réforme éducative audacieuse : les langues maternelles deviennent désormais la langue principale d’enseignement dans les premières années de scolarité. Dès la maternelle jusqu’à la 3ᵉ année du primaire, les élèves apprendront à lire, écrire et comprendre dans leur langue locale. « Quand l’enfant comprend la langue locale, il apprend plus vite », explique un instituteur de Kumasi. Cette décision, annoncée comme structurante pour les générations futures, suscite déjà admiration et débat en Afrique centrale. Et si ce modèle inspirait bientôt le Cameroun ?
Une réforme éducative qui marque un tournant
Au Ghana, les langues telles que le twi, l’ewe, le dagbani, le ga ou encore le akan seront désormais au cœur de l’apprentissage de base.
L’objectif affiché par le gouvernement :
- améliorer la compréhension et la mémorisation,
- renforcer les identités culturelles locales,
- et réduire l’échec scolaire, notamment en zones rurales.
Les premières études pilotes, menées dans plusieurs districts éducatifs, auraient montré une nette progression de la lecture et de l’écriture dès la première année, comparativement aux classes où l’anglais dominait.
« Lorsqu’un enfant apprend dans la langue qu’il parle à la maison, son intelligence se déploie plus vite. Ce n’est pas seulement pédagogique, c’est psychologique », analyse un linguiste ghanéen de l’Université du Cap Coast.
Et au Cameroun ? Une question qui dérange
Au Cameroun, le débat n’est pas nouveau, mais il reste sensible.
Le pays compte plus de 250 langues nationales, mais l’enseignement repose toujours majoritairement sur le français et l’anglais, héritages de la colonisation.
Pourtant, plusieurs chercheurs de l’ENS Yaoundé l’affirment depuis des années :
l’utilisation des langues locales en début de scolarité réduit les abandons et développe la confiance des enfants.
Une comparaison qui interpelle
- Ghana : réforme appliquée nationalement
- Cameroun : initiatives locales, isolées, souvent expérimentales
Alors que les tensions identitaires et linguistiques restent vives dans certaines régions, adopter un modèle similaire pourrait également renforcer la cohésion nationale, selon certains analystes.
Un choix culturel, politique et économique
La réforme ghanéenne n’est pas seulement éducative :
elle porte une vision.
Elle affirme que la modernité africaine n’exclut pas les racines, et que le développement ne nécessite pas l’effacement des identités.
Dans un contexte où le numérique et la création de contenus locaux explosent, parler, écrire et penser dans sa langue devient un enjeu de souveraineté cognitive.
Conclusion
Le Ghana a fait un pas important : enseigner l’enfant dans la langue qui habite son cœur.
Une démarche qui rappelle une vérité simple mais profonde : on apprend mieux quand on se reconnaît dans ce que l’on apprend.
👉 Alors, le Cameroun osera-t-il suivre cette voie ?