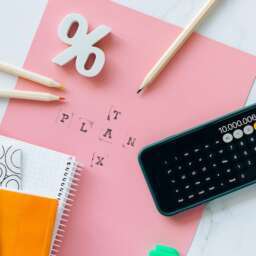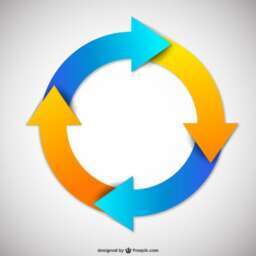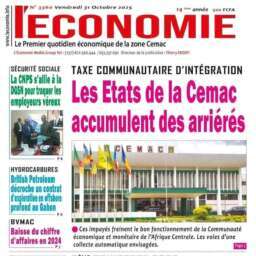Rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 dévoile ses conclusions explosives dans un document de 1000 pages remis en janvier 2025 qui révolutionne la compréhension de la décolonisation camerounaise. Cette enquête historique sans précédent, dirigée par Karine Ramondy et Blick Bassy, établit définitivement l’existence d’une « guerre » française contre l’UPC avec des « violences répressives de nature multiple ». Le rapport documente méticuleusement 26 années de répression coloniale et postcoloniale grâce à l’accès inédit aux archives classifiées. Une somme académique qui contraint Emmanuel Macron à reconnaître officiellement les crimes français dans sa lettre du 30 juillet 2025.
Genèse et méthodologie : enquête historique d’envergure inédite
Le rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 naît de l’engagement solennel pris par Emmanuel Macron lors de sa visite officielle à Yaoundé en juillet 2022. « Prendre l’engagement solennel d’ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d’historiens qui nous permettront d’éclairer ce passé », avait déclaré le président français devant Paul Biya.
Cette commission mixte, structure diplomatique innovante, rassemble huit historiens français et camerounais sous la co-direction de Karine Ramondy, docteure en histoire contemporaine et spécialiste des questions coloniales, et Blick Bassy, artiste camerounais engagé et défenseur de la mémoire africaine. Cette parité franco-camerounaise garantit l’objectivité des travaux menés.
L’accès privilégié aux fonds d’archives constitue la force principale de cette investigation. Les chercheurs bénéficient d’une dérogation exceptionnelle pour consulter plus de 15 000 documents classifiés conservés aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, au Service historique de la Défense à Vincennes, et dans les fonds diplomatiques du Quai d’Orsay.
Les archives militaires du Cameroun, longtemps inaccessibles, s’ouvrent également aux investigations. Cette réciprocité archivistique permet un croisement inédit des sources françaises et camerounaises pour reconstituer la vérité historique.
La commission adopte une méthodologie rigoureuse combinant dépouillement d’archives, collecte de témoignages oraux et analyse comparative avec d’autres contextes de décolonisation. Cette approche pluridisciplinaire enrichit considérablement la compréhension des événements.
Les historiens interrogent également les derniers témoins directs de cette période. Ces entretiens, menés dans toutes les régions du Cameroun, recueillent la parole des anciens combattants UPC, des victimes civiles et de leurs familles. Cette dimension humaine complète l’approche documentaire.
Le financement conjoint de cette commission par les deux États témoigne de leur engagement dans cette démarche de vérité. Un budget de 2,5 millions d’euros permet le fonctionnement de cette structure pendant trois années d’investigations intensives.
Les travaux s’organisent autour de cinq groupes thématiques : répression politique, opérations militaires, violences contre les populations civiles, dimension internationale du conflit, et héritage mémoriel. Cette spécialisation permet une expertise approfondie de chaque aspect.
La commission bénéficie également du soutien logistique des universités partenaires. L’Université de Yaoundé I, la Sorbonne, l’École normale supérieure et l’Institut d’études politiques de Paris mettent leurs ressources documentaires à disposition.
Cette collaboration académique internationale enrichit les perspectives d’analyse. Des chercheurs spécialistes de l’Algérie, du Vietnam et d’autres contextes coloniaux apportent leur expertise comparative pour éclairer la spécificité camerounaise.
Révélations majeures : anatomie d’une guerre coloniale occultée
Le rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 révèle l’ampleur insoupçonnée de la répression française contre les mouvements indépendantistes camerounais. « La genèse de l’affrontement entre les autorités coloniales et les oppositions indépendantistes au prisme du temps long de la situation coloniale (1945-1955) » constitue la première partie de cette investigation.
Cette période fondatrice voit naître l’Union des populations du Cameroun (UPC) en 1948 sous l’impulsion de Ruben Um Nyobe, Felix Moumié et Ernest Ouandié. Le rapport documente précisément comment ce mouvement politique légal se radicalise face à l’intransigeance coloniale française.
L’interdiction de l’UPC en juillet 1955 marque le basculement vers la violence armée. « Le glissement des répressions politique, diplomatique, policière et judiciaire vers la guerre menée par l’armée française (1955-1960) » constitue le cœur de l’analyse historique.
Les opérations militaires françaises révélées par le rapport dépassent largement ce qui était connu publiquement. L’opération « Hirondelle » en 1957 mobilise 15 000 soldats français contre les maquis bamilékés de l’Ouest. Cette ampleur militaire atteste de l’intensité du conflit.
La stratégie de « quadrillage » appliquée au Cameroun s’inspire directement des méthodes utilisées en Indochine. Les officiers français expérimentés du conflit vietnamien importent leurs techniques de contre-insurrection dans la colonie africaine.
Les « camps de regroupement » documentés par la commission révèlent une politique de déplacement forcé massif des populations civiles. Plus de 200 000 personnes, essentiellement des Bamilékés, sont concentrées dans ces structures de contrôle entre 1957 et 1962.
Les conditions de vie dans ces camps s’avèrent effroyables selon les témoignages recueillis. Surpopulation, malnutrition, absence d’hygiène et violences constituent le quotidien de ces populations déplacées. La mortalité y atteint des taux dramatiques.
Le rapport documente également l’usage systématique de la torture contre les prisonniers UPC. Les techniques employées incluent la « gégène » (électrochocs), l’immersion forcée, les sévices sexuels et les mutilations. Ces pratiques visent à briser psychologiquement la résistance indépendantiste.
L’assassinat des leaders UPC fait l’objet d’analyses détaillées. La mort de Ruben Um Nyobe le 13 septembre 1958 résulte d’une opération planifiée impliquant les services secrets français. L’empoisonnement de Felix Moumié à Genève en 1960 révèle l’extension internationale de cette guerre secrète.
Le bilan humain établi par la commission dépasse largement les estimations antérieures. « 7 500 combattants tués entre 1956 et 1962 » selon les archives militaires françaises, mais ce chiffre ne comptabilise que les morts au combat officiellement recensés.
La réalité s’avère bien plus dramatique en incluant les victimes civiles, les disparus et les morts dans les camps. Le rapport estime entre 60 000 et 100 000 le nombre total de Camerounais tués durant cette période. Cette réévaluation fait du conflit camerounais l’un des plus meurtriers de la décolonisation africaine.
L’utilisation d’armes chimiques par l’armée française constitue l’une des révélations les plus choquantes. Des bombardements au napalm visent les zones de maquis dans l’Ouest et le Sud du pays. Ces attaques chimiques contaminent durablement l’environnement et causent des malformations sur plusieurs générations.
La dimension économique de cette guerre apparaît également dans le rapport. Les entreprises françaises implantées au Cameroun financent directement les opérations militaires pour protéger leurs intérêts. Cette collusion public-privé révèle les enjeux financiers sous-jacents au conflit.
Continuité post-indépendance : néocolonialisme armé documenté
La section la plus novatrice du rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 concerne la période post-indépendance. « L’action des forces françaises se poursuit malgré la transition politique et l’indépendance du Cameroun (1960-1965) – et même au-delà, l’aide française se maintenant dans le cadre de la coopération (1965-1971) ».
Cette continuité démontre que l’indépendance formelle du 1er janvier 1960 ne met pas fin à l’intervention militaire française. Les accords de coopération signés avec Ahmadou Ahidjo légalisent le maintien de conseillers militaires français et l’usage de l’armée française contre l’opposition.
Le rapport révèle l’existence d’une « Doctrine française de maintien de l’ordre au Cameroun indépendant » élaborée en 1961. Ce document secret codifie les méthodes de répression à appliquer contre les survivants de l’UPC et leurs sympathisants.
Les opérations militaires se poursuivent dans l’Ouest et le Sud du pays jusqu’en 1965. L’exécution d’Ernest Ouandié en janvier 1971 marque symboliquement la fin de cette guerre de 16 ans. Cette continuité temporelle révèle l’ampleur du contrôle néocolonial français.
Les conseillers militaires français encadrent directement l’armée camerounaise naissante. Le général Max Briand, ancien d’Indochine, supervise personnellement la formation des officiers camerounais aux techniques de contre-insurrection héritées des conflits coloniaux.
Cette formation inclut l’enseignement des méthodes de torture et d’interrogatoire. Les stages dispensés au Cameroun et en France transmettent ces pratiques répressives aux cadres de sécurité camerounais. Cette continuité institutionnelle explique la persistance de ces méthodes après l’indépendance.
Le rapport documente également l’implication française dans la mise en place du système politique autoritaire d’Ahmadou Ahidjo. Les conseillers de l’Élysée participent directement à la rédaction de la Constitution de 1961 qui instaure un régime présidentiel fort.
Cette ingérence politique s’accompagne d’un contrôle économique renforcé. Les accords de coopération garantissent aux entreprises françaises un accès privilégié aux ressources camerounaises. Cette domination économique constitue l’objectif ultime de cette intervention militaire prolongée.
Les services secrets français maintiennent également un réseau d’informateurs au sein de l’administration camerounaise. Cette surveillance permet d’anticiper et de neutraliser toute velléité d’indépendance réelle des dirigeants camerounais.
Le rapport établit que Jacques Foccart, « Monsieur Afrique » du général de Gaulle, supervise personnellement cette politique néocoloniale au Cameroun. Ses archives personnelles, récemment ouvertes, révèlent l’ampleur de cette tutelle française sur le jeune État indépendant.
Cette mainmise française explique la stabilité relative du Cameroun post-indépendance comparée à d’autres pays africains. Cette stabilité résulte directement de l’élimination physique de l’opposition et de la mise sous tutelle des institutions nationales.
Impact diplomatique et perspectives : reconnaissance historique obtenue
Les conclusions du rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 contraignent Emmanuel Macron à une reconnaissance historique sans précédent dans sa lettre du 30 juillet 2025. « Clairement fait ressortir qu’une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l’armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple », admet officiellement le président français.
Cette reconnaissance marque un tournant dans la politique mémorielle française en Afrique. Après les rapports sur le Rwanda et l’Algérie, le Cameroun devient le troisième dossier où la France assume explicitement ses responsabilités dans les violences coloniales.
Karine Ramondy salue cette évolution comme « une réparation symbolique très forte » qui « permet enfin aux victimes et à leurs familles d’obtenir la reconnaissance de leurs souffrances ». Cette validation présidentielle consacre trois années de travaux académiques rigoureux.
Blick Bassy, co-directeur camerounais, souligne l’importance de cette vérité historique pour la réconciliation nationale camerounaise. « Ce rapport libère la parole sur des événements longtemps occultés et permet au Cameroun de se réconcilier avec son histoire », déclare l’artiste engagé.
Les réactions au Cameroun témoignent de l’attente considérable suscitée par ce rapport. Mathieu Njassep, président de l’Association des vétérans camerounais, exprime sa satisfaction : « Enfin, nos témoignages sont validés par des preuves documentaires irréfutables ».
Cette reconnaissance ouvre concrètement la voie à des demandes de réparations. « La France a commis beaucoup de crimes au Cameroun. Elle peut payer des réparations », revendique Mathieu Njassep, fort de ces révélations officielles.
La question des réparations, absente de la lettre de Macron, constituera probablement le prochain enjeu des relations franco-camerounaises. Les précédents allemand en Namibie ou belge au Congo pourraient inspirer les négociations futures.
Ce rapport influence également la campagne présidentielle camerounaise d’octobre 2025. Paul Biya, architecte de cette reconnaissance française, en fait un argument de sa candidature à un huitième mandat. Cette victoire diplomatique renforce sa stature internationale.
L’opposition camerounaise salue également ces révélations tout en déplorant leur instrumentalisation électorale. Maurice Kamto, dont la candidature a été rejetée, dénonce « une manœuvre de diversion » face aux problèmes actuels du pays.
Sur le plan académique, ce rapport ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Les 1000 pages constituent désormais la référence incontournable sur la décolonisation camerounaise. De nombreuses thèses et travaux s’appuieront sur ces découvertes.
L’impact international de ce rapport dépasse le cadre franco-camerounais. D’autres pays africains s’inspirent de cette démarche pour obtenir des reconnaissances similaires de leurs anciennes puissances coloniales.
Le modèle de commission mixte expérimenté au Cameroun pourrait être reproduit ailleurs. Cette innovation diplomatique réconcilie exigence scientifique et enjeux politiques dans la gestion des contentieux mémoriels.
Les suites concrètes de ce rapport incluent la création d’un centre de documentation sur la décolonisation camerounaise. Cette structure, implantée à Yaoundé, conservera les archives collectées et facilitera les recherches futures.
Un programme d’échanges universitaires franco-camerounais accompagne cette démarche mémorielle. Les étudiants des deux pays bénéficieront de bourses spécifiques pour approfondir ces questions historiques.
Cette rapport de la commission franco-camerounaise 1945-1971 marque définitivement une rupture dans l’écriture de l’histoire franco-africaine. La vérité historique, longtemps occultée, éclaire enfin cette page sombre de la décolonisation.
Ces révélations académiques déboucheront-elles sur une réconciliation durable et des réparations concrètes pour les victimes et leurs descendants ?