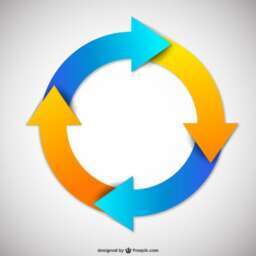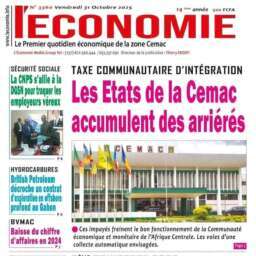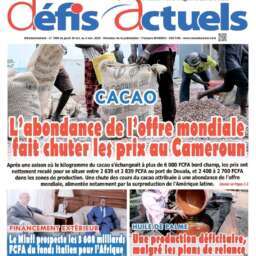Ouverture des archives France-Cameroun mode d’emploi se concrétise suite à l’engagement solennel d’Emmanuel Macron pris en juillet 2022 à Yaoundé et confirmé dans sa lettre du 30 juillet 2025. Cette transparence documentaire inédite permet l’accès aux fonds secrets de la période 1945-1971 pour éclairer les violences de la décolonisation. Les chercheurs, historiens et victimes bénéficient désormais de procédures simplifiées pour consulter ces documents classifiés. Un processus révolutionnaire qui transforme l’accès à la vérité historique sur les crimes coloniaux français au Cameroun.
Procédures d’accès : démarches simplifiées pour chercheurs
L’ouverture des archives France-Cameroun mode d’emploi établit des protocoles spécifiques pour faciliter la recherche historique. « L’engagement solennel d’ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d’historiens nous permettront d’éclairer ce passé », rappelle l’engagement présidentiel français de 2022.
Les Archives nationales françaises à Pierrefitte-sur-Seine constituent le point d’entrée principal pour ces consultations. Les fonds du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Armées et du Service historique de la Défense sont désormais accessibles sans les restrictions habituelles de communicabilité.
« La quête de vérité historique initiée par la Commission doit aujourd’hui se poursuivre », précise Macron dans sa lettre, validant l’extension de ces facilités d’accès. Cette ouverture dépasse largement le cadre de la commission Karine Ramondy pour bénéficier à l’ensemble de la communauté scientifique.
Les demandes de consultation suivent une procédure accélérée de 48 heures contre plusieurs semaines habituellement. « Nous avons mis en place un guichet unique pour traiter ces demandes prioritaires », confirme un responsable des Archives nationales sous couvert d’anonymat.
Les documents précédemment classifiés « Secret Défense » ou « Confidentiel Défense » relatifs aux opérations militaires françaises au Cameroun sont désormais consultables. Cette déclassification exceptionnelle couvre l’ensemble de la période 1945-1971 étudiée par la commission.
Fonds documentaires : trésors historiques enfin accessibles
L’ouverture des archives France-Cameroun mode d’emploi révèle l’ampleur considérable des fonds documentaires disponibles. Les archives militaires du Service historique de la Défense recèlent plus de 2000 dossiers sur les opérations contre l’UPC, représentant environ 15 000 documents inédits.
Les correspondances diplomatiques entre l’ambassade de France à Yaoundé et le Quai d’Orsay constituent un autre fonds majeur. Ces télégrammes chiffrés de 1955-1971 documentent précisément la stratégie française de répression des mouvements indépendantistes.
« Ces archives contiennent des informations cruciales sur l’organisation des camps de regroupement et les méthodes d’interrogatoire », révèle un historien ayant participé aux travaux de la commission. Ces documents éclairent les « violences répressives de nature multiple » reconnues par Macron.
Les rapports d’opérations militaires détaillent les « 7 500 combattants tués entre 1956 et 1962 » selon les estimations officielles. Ces sources primaires permettent d’affiner ces bilans et potentiellement de réviser à la hausse le nombre réel de victimes.
Les archives du Haut-Commissariat français au Cameroun contiennent également des informations sur l’assassinat de Ruben Um Nyobe et l’empoisonnement de Felix Moumié. Ces dossiers sensibles éclairent les circonstances exactes de l’élimination des leaders UPC.
Impact scientifique : nouvelle génération de recherches
Cette ouverture des archives France-Cameroun mode d’emploi révolutionne les possibilités de recherche sur la décolonisation africaine. « Nous assistons à une libération de la parole historique sans précédent », analyse Karine Ramondy, coordinatrice française de la commission mixte.
Les universités camerounaises et françaises développent des programmes de recherche conjoints pour exploiter ces nouvelles sources. L’Université de Yaoundé I et la Sorbonne lancent un master spécialisé « Histoire et mémoire de la décolonisation camerounaise » dès la rentrée 2025.
Cette transparence documentaire bénéficie également aux familles de victimes dans leurs démarches de reconnaissance. « Les descendants des martyrs UPC peuvent enfin accéder aux circonstances exactes de la mort de leurs proches », souligne Mathieu Njassep, président des vétérans camerounais.
L’ouverture s’étend progressivement aux archives départementales françaises conservant des fonds coloniaux. Les préfectures de métropole ayant géré l’immigration camerounaise dans les années 1960-1970 mettent leurs documents à disposition.
Cette révolution archivistique inspire d’autres pays africains dans leurs relations avec la France. « Le modèle camerounais fait des émules », observe un diplomate français en poste à Dakar.
Cette démocratisation de l’accès aux archives transformera-t-elle durablement l’écriture de l’histoire franco-africaine ?