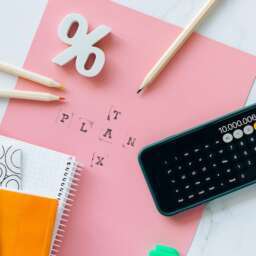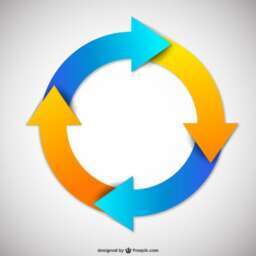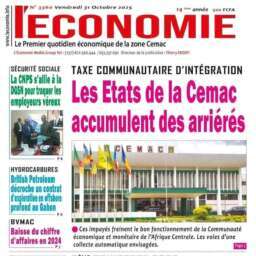Le Massacre des Bamilékés au Cameroun émerge comme la dimension la plus tragique de la reconnaissance française des crimes coloniaux dans la lettre de Macron du 30 juillet 2025. Cette répression ciblée contre l’ethnie de l’Ouest camerounais représente l’aspect le plus sombre des « violences répressives de nature multiple » admises par le président français. Les populations bamilékés, accusées de soutenir massivement l’UPC, subissent un acharnement particulier des forces coloniales entre 1955 et 1971. Cette reconnaissance officielle éclaire enfin l’ampleur d’une tragédie ethnique occultée pendant plus de 60 ans.
Ciblage ethnique : Les Bamilékés dans le viseur colonial
Le massacre des Bamilékés au Cameroun résulte d’une stratégie délibérée de répression collective contre cette ethnie de l’Ouest. « Les autorités coloniales et l’armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple », reconnaît Macron, validant la réalité de cette persécution ciblée.
L’Ouest camerounais, terre ancestrale des Bamilékés, devient le théâtre principal de cette répression. Les villages de Bafoussam, Dschang, Mbouda et leurs environs subissent des opérations militaires d’une brutalité inouïe entre 1957 et 1964.
« Plusieurs dizaines de milliers » de victimes selon les estimations revisées des historiens, majoritairement des Bamilékés civils. Ces chiffres dépassent largement les « 7 500 combattants tués » officiellement comptabilisés par l’armée française.
Les « déplacements forcés des civils vers des camps de regroupement » visent spécifiquement les populations bamilékés suspectées de sympathie UPC. Ces camps de concentration improvisés dans l’Ouest concentrent des milliers de familles dans des conditions inhumaines.
La stratégie française de « terre brûlée » dans les zones bamilékés détruit systématiquement villages, cultures et structures sociales traditionnelles. Cette politique vise l’anéantissement culturel autant que physique de cette communauté résistante.
Acharnement particulier : Ouest Cameroun zone d’extermination
L’intensité du massacre Bamilékés Cameroun révèle l’acharnement particulier des forces coloniales contre cette ethnie jugée « rebelle ». « La guerre s’est poursuivie au-delà de 1960 avec l’appui de la France », précise Macron, confirmant la continuité de cette répression.
Les chefferies traditionnelles bamilékés, piliers de l’organisation sociale, deviennent des cibles prioritaires. Les fo (chefs traditionnels) suspectés de soutenir l’UPC sont systématiquement éliminés ou emprisonnés dans des conditions épouvantables.
« Pratiques de torture » documentées par la commission Karine Ramondy révèlent des méthodes spécifiquement appliquées aux prisonniers bamilékés. Ces techniques visent à briser la résistance communautaire par la terreur collective.
Les femmes bamilékés subissent des violences sexuelles massives comme arme de guerre psychologique. Ces crimes, longtemps occultés, émergent enfin grâce à l’ouverture des archives militaires françaises.
L’extermination des intellectuels et cadres bamilékés vise à décapiter cette société organisée. Instituteurs, infirmiers, commerçants et artisans sont systématiquement pourchassés pour leur influence sociale présumée.
Mémoire retrouvée : reconnaissance tardive des souffrances
Cette admission du massacre des Bamilékés au Cameroun honore enfin la mémoire de ces victimes oubliées de l’histoire officielle. « Il me revient d’assumer aujourd’hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements », déclare Macron, reconnaissant cette tragédie ethnique.
Mathieu Njassep, président des vétérans camerounais, salue cette reconnaissance particulière. « Les Bamilékés ont payé le prix fort de la résistance à l’oppression coloniale », témoigne-t-il avec émotion.
Les familles bamilékés disposent désormais de cette reconnaissance officielle pour leurs démarches mémorielles. Cette validation présidentielle française légitime leurs revendications de réparations spécifiques.
L’Ouest Cameroun, région martyrisée, peut enfin faire reconnaître ses souffrances particulières. Cette spécificité ethnique de la répression coloniale éclaire d’un jour nouveau l’histoire de la décolonisation camerounaise.
Cette reconnaissance du massacre des Bamilékés au Cameroun ouvre la voie à des recherches approfondies sur cette tragédie. Les archives françaises révéleront progressivement l’ampleur réelle de cette persécution ciblée contre une ethnie entière.
Cette reconnaissance spécifique des souffrances bamilékés favorisera-t-elle une réconciliation nationale autour de cette mémoire partagée ?