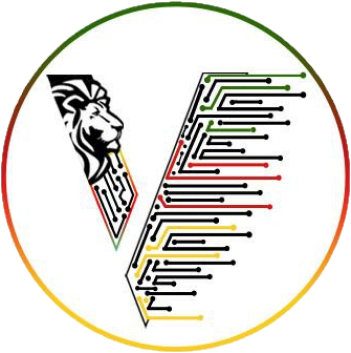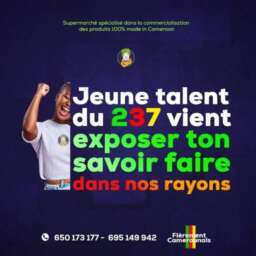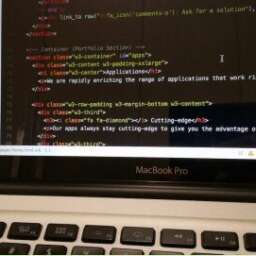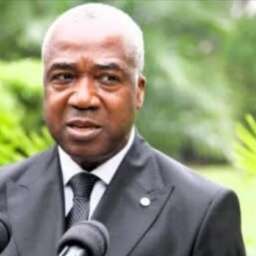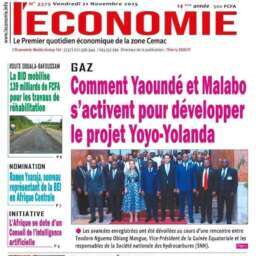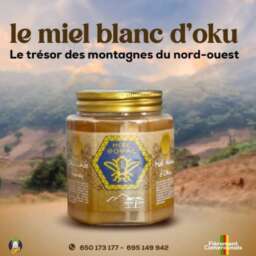(Investir au Cameroun) – Le secteur minier camerounais, riche en ressources telles que l’or, le fer, la bauxite ou encore le cobalt, reste freiné dans sa transformation et son impact économique par plusieurs obstacles majeurs. Réunis le 15 mai 2025 à Douala, lors d’un débat placé sous le thème « Le secteur minier camerounais entre opportunités économiques et exigences éthiques », plusieurs experts ont mis en lumière ces freins persistants. Cet événement, coorganisé par le cabinet d’intelligence économique Innogence Consulting de l’analyste Landry Djimpe, le cabinet Nya & Co Law Firm et l’avocate spécialisée en conformité Lucie Nzongang, a notamment pointé le manque de transparence dans l’attribution des permis miniers, l’insuffisance d’énergie pour la transformation locale des minerais et une fiscalité jugée peu incitative.
Selon le ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique (Minmidt), une vaste campagne de levés géophysiques aéroportés, conduite entre 2014 et 2019, a permis d’identifier environ 500 nouveaux sites miniers inexploités répartis dans cinq régions (Est, Ouest, Adamaoua, Nord, Centre). Ces sites recèlent des ressources variées allant de l’or au fer, en passant par la bauxite et le cobalt. Mais malgré ce potentiel géologique reconnu, la contribution du secteur minier au produit intérieur brut (PIB) reste inférieure à 1 %, selon les données officielles.
Déficit énergétique
Pour transformer ce potentiel en richesse économique, l’énergie reste un levier incontournable. À Grand-Zambi, dans la région du Sud, la société G-Stones Resources S.A — filiale du groupe Bocom de l’homme d’affaires Dieudonné Bougne — exploite un important gisement de fer. Son projet sidérurgique prévoit la transformation annuelle d’un million de tonnes de concentrés de fer en 800 000 tonnes de billettes destinées aux aciéries locales. « Ce complexe a besoin de 70 MW pour fonctionner », indique Éric Igor Ngantchou, chef de division études et gestion des projets chez Bocom.
Or, la capacité énergétique disponible reste largement insuffisante, notamment à Kribi, où le port en eau profonde est appelé à devenir une plateforme logistique majeure pour l’évacuation des matières premières. Patrice Loumou, responsable de la prospective industrielle au Port autonome de Kribi (PAK), révèle que la ville ne dispose que de 13 MW sur les 176 MW produits par la centrale thermique de Globeleq. Le reste de cette production est injecté dans le Réseau interconnecté Sud (RIS), privant les industries locales de l’énergie nécessaire à leur démarrage.
Le défi fiscal
La fiscalité constitue un autre point d’achoppement. Clotaire Kouakep Nzengang, sous-directeur des activités minières au Minmidt, indique que les taxes sur la production artisanale et semi-artisanale atteignent 25 % du volume extrait. Il précise néanmoins que l’État peut exercer un droit de préemption sur les 75 % restants, à condition d’en avoir les moyens. « Dans le cas contraire, il délivre une attestation, et c’est seulement à ce moment qu’on peut procéder à l’exportation », explique-t-il.
Ce mécanisme de partage vise à garantir une meilleure valorisation des ressources au bénéfice de l’État. Inscrit dans la Stratégie nationale de développement (SND30), le secteur minier est identifié comme un pilier majeur de la croissance, à travers l’axe mine-métallurgie-sidérurgie. Pour encadrer ce processus, le Cameroun s’est doté en 2023 d’un nouveau code minier, que les autorités présentent comme un dispositif attractif et compétitif, basé sur le principe « premier venu, premier servi ».
Insécurité juridique
Ce cadre prévoit également le développement de projets intégrés, une meilleure connaissance du sous-sol, la valorisation des données géologiques et l’implication des communautés locales dans la mise en œuvre des projets. Mais malgré ces ambitions, le cadre reste critiqué.
Selon Me Sarada Nya, avocate d’affaires au cabinet Nya & Co, « le chevauchement des compétences institutionnelles, l’absence de registres miniers accessibles, et la non-publication complète des contrats miniers sont autant de zones d’ombre ». Huit décrets d’application sur neuf ont certes été publiés, mais l’experte souligne de sérieuses lacunes, notamment sur les mécanismes d’arbitrage international.
« L’absence d’un système fiable d’arbitrage et les imprécisions fiscales, comme les droits variables sans méthode de calcul claire, génèrent une incertitude préjudiciable. Les révisions rétroactives de contrats, comme dans le projet Mbalam, ont provoqué des contentieux lourds et un gel des investissements estimé à 120 millions de dollars », souligne-t-elle. Ces pratiques remettent en cause le principe de sécurité juridique pourtant inscrit dans le Code minier.
Face à ces défis, les acteurs du secteur appellent à une synergie accrue entre les pouvoirs publics, les investisseurs et les communautés locales. Ils estiment qu’avec des réformes plus audacieuses, le Cameroun peut bâtir une industrie minière forte, capable de peser véritablement dans l’économie nationale.
Frédéric Nonos
Lire aussi: